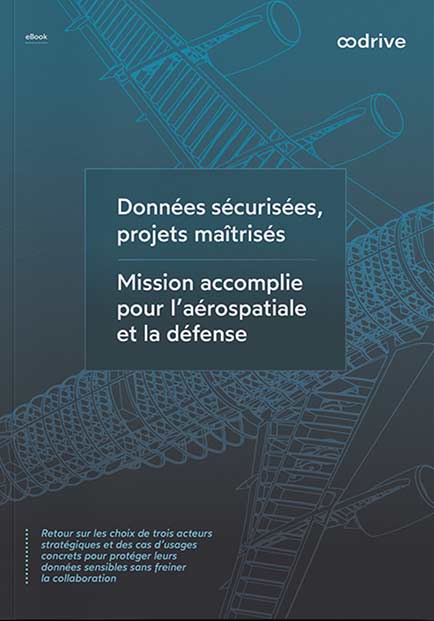Reaper, Predator, nEUROn, X-47B, les drones sont de plus en plus présents dans le domaine militaire. Qu’ils effectuent des missions de surveillance, de reconnaissance, de renseignement, ou encore d’attaque, ils sont devenus des « armes » à part entière, une composante essentielle, un enjeu technologique d’importance pour les États qui cherchent à développer leur puissance militaire.
Stéphane Taillat, agrégé et docteur en Histoire, est enseignant-chercheur aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et membre cofondateur de l’Alliance Géostratégique. Il détaille pour le Journal de l’Aviation les changements induits par l’introduction des drones dans les opérations militaires.
De quelle manière les drones ont-ils changé la manière de faire la guerre?
L’utilisation des drones suggère un changement tactique dans la continuité des décennies précédentes. A savoir la mise en œuvre d’armes de précision à longue portée réputées plus discriminantes. Du fait de ces qualités, le drone est capable de mener des actions de décapitation précises au service d’une stratégie plus globale visant à déséquilibrer les organisations insurgées – comme c’est le cas pour les Américains au Pakistan, au Yémen, en Afghanistan et certainement en Somalie. Par la peur qu’ils suscitent, par leur efficacité tactique, les drones concourent à perturber le rythme opérationnel des insurgés ainsi qu’à une stratégie d’attrition, qui ne vise pas à anéantir l’organisation mais à épuiser ses capacités de renfort et, au-delà, de réaction.
Ces remarques proviennent notamment du cas américain, le seul en fait. L’utilisation des drones s’inscrit dans une volonté politique de minimiser l’engagement « visible » au sol afin de réduire les coûts politiques d’une intervention longue et onéreuse En d’autres termes, l’intensification de l’utilisation des drones depuis l’élection du président Obama doit se comprendre comme une réaction aux engagements en Afghanistan et en Irak. Mais plus globalement, il s’agit aussi de circonscrire l’objectif militaire et politique au démantèlement des réseaux liés à Al-Qaïda et non plus à faire de la stabilisation sur le long terme. Bien sur, les drones pourraient être utilisés dans ce cas aussi, mais leurs capacités techniques permettent d’en faire usage dans le cadre d’une stratégie plus indirecte.
Au final, je ne dirai pas que les drones changent la manière de faire la guerre. Le drone est une arme, un outil, et à ce titre son apport n’est pas « révolutionnaire ». En revanche, il permet de mettre en œuvre une palette plus large de stratégies, avec le risque de devenir un outil sur lequel on fait peser trop d’attentes. Ne s’en remettre qu’aux drones pour achever les objectifs politiques et sécuritaires américains vis à vis d’Al-Qaïda et de ses affiliés est en effet naïf : les drones permettent de maintenir une pression sur ceux-ci, mais la sécurité qui en découle pour les États-Unis et leurs alliés n’en est que temporaire.
L’utilisation des drones sur les théâtres d’opérations pose-t-elle des problèmes d’éthique (entre autres en Afghanistan)?
Les problèmes juridiques et éthiques posés par les drones sont de plusieurs ordres. Il y a d’abord, mis à part le cas de l’Afghanistan, le fait que les Américains l’utilisent sur des territoires réputés souverains – avec l’accord plus ou moins tacite et plus ou moins complice des autorités locales lorsque celles-ci existent encore. Autrement dit, le drone permet plus facilement de s’ingérer dans les affaires d’un autre État.
Ensuite se posent les questions liées aux dommages collatéraux et à la manière d’en tenir compte. Le fait de considérer par exemple tous les hommes en âge de porter des armes comme des combattants – et donc des cibles légitimes – est un choix, dont il faut assumer le fait qu’il n’est pas accepté par tous (Organisations internationales, non-gouvernementales, populations locales, etc.) Enfin, plus récemment, certains ont mis en exergue les risques liés à l’éloignement du champ de bataille de la part du pilote humain, conduisant à « déréaliser » la guerre pour ce dernier (la guerre comme un jeu vidéo), voire les risques liés à l’automatisation de l’appareil.
Il faut rappeler que ces questions et dilemmes ne peuvent pas être tranchés de manière unilatérale : il faut prendre en compte aussi tout l’imaginaire qui se construit autour des drones et de leur usage. Car en effet, l’image et la perception des drones par les audiences multiples, les pilotes, les ennemis, les populations locales, la communauté internationale, dépendent aussi de ces rapports de force. Ainsi, si les drones sont vécus comme une menace par les populations locales, cela peut être autant dû à d’éventuels dommages collatéraux antérieurs qu’à l’omniprésence et partant, l’impression d’omnipotence, de l’arme.
Le drone de combat (UCAV) est-il un acteur d’avenir face aux avions – notamment de combat ?
Très clairement, les drones présentent des avantages comparatifs par rapport aux avions de combat. Mais il faut noter trois choses.
Premièrement, les drones ne remplacent pas les avions de combat, ceux-ci étant encore majoritairement utilisés sur un théâtre comme l’Afghanistan et y compris dans une stratégie de frappes ciblées.
En second lieu, les drones ne peuvent affronter des avions de combat tant leur vitesse que leur protection restent insuffisantes. Cela signifie que leur utilisation dépendra étroitement du contexte et de l’adversaire.
En troisième lieu, les drones restent davantage un outil d’appoint dont il ne faut pas exagérer l’efficacité et l’efficience. En d’autres termes, les avions de combat classiques restent des systèmes d’armes privilégiés.
Comment expliquer cette « course technologique », au-delà de la dimension de réduction des coûts d’exploitation?
La course technologique qui semblerait s’amorcer, mais qui relève aussi du discours stratégique américain propre à la technologie, peut s’expliquer avant tout par la perception de l’efficacité et de l’efficience de la plate-forme mais aussi par les jeux bureaucratiques subtils entre armées au sein d’un même appareil de défense. Sans compter un phénomène d’imitation par rapport à un modèle défini par les Américains, lesquels restent la référence d’un régime militaire « réglé »…