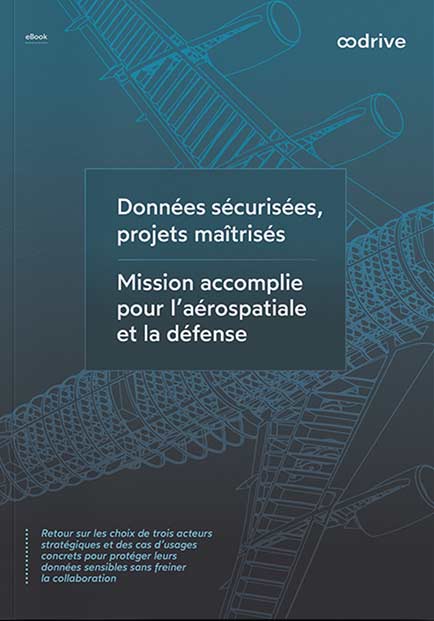La DGAC est montée au créneau pour défendre ses contrôleurs aériens. La profession a en effet été mise en cause par Le Figaro dans son édition du 23 septembre, le quotidien les ayant accusés de mettre en péril la sécurité des opérations en arrangeant illégalement leurs journées de travail, ce qui les conduit à travailler régulièrement en sous-effectif. Le ministre des Transports Dominique Bussereau a immédiatement demandé un rapport sur la situation décrite et les incidents relatés, qui lui a été remis le 24 septembre par le directeur de la DGAC Patrick Gandil.
Dans son article, Le Figaro met en cause le système de clairance, qui permettrait aux contrôleurs d’organiser leur temps de travail et leurs rotations et les mènerait à ne travailler que la moitié du temps réglementaire. Ils doivent en effet être à leur poste vingt-quatre heures par semaine et cent soixante jours par an ; le journal déclare que, dans les faits, ils n’y sont que douze heures par semaine et quatre-vingts jours par an.
Première conséquence de cette situation : ils travailleraient parfois en sous-effectif. Seconde conséquence : les contrôleurs sont amenés à gérer plusieurs zones à la fois et à regrouper plusieurs fréquences radio, ce qui peut nuire à la sécurité des opérations. Le journal a rapporté trois incidents graves, des « rapprochements anormaux », qui auraient pu entraîner des accidents.
La DGAC riposte
La Direction Générale de l’Aviation Civile a répondu dans son rapport que le système de clairance existait effectivement mais qu’en aucun cas il n’avait mené à une période de sous-effectif. En vigueur dans plusieurs pays européens, il permet aux contrôleurs de quitter parfois prématurément la tour de contrôle car le trafic annoncé est faible. Mais dans tous les cas, lors de l’organisation des tours de service des équipes, les chefs d’équipe « gardent une certaine latitude pour adapter finement le nombre de positions de contrôle ouvertes à la demande réelle de trafic. » Ainsi, un contrôleur peut ne pas armer une position mais se trouver tout de même en salle, prêt à le faire si besoin. Patrick Gandil reconnaît toutefois que ces pratiques sont difficiles à mesurer car officieuses.
Quant aux trois collisions évitées de justesse, la DGAC n’en reconnaît qu’une. Le 18 février 2007, un contrôleur a commis un lapsus en ordonnant à un Air France de virer à gauche au lieu de virer à droite. Mais selon la DGAC, l’erreur a été détectée par le système de « filet de sauvegarde » intégré à l’écran du contrôleur, ce qui lui a permis de rectifier son ordre. Le Figaro comme la commission d’analyse de la sécurité considèrent que la charge de travail a pu être un facteur contributif. Mais la DGAC estime que l’incident aurait également pu intervenir si les fréquences radio avaient été dégroupées et qu’il a aussi pu être causé par une stratégie complexe d’utilisation de piste visant à réduire le roulage des appareils.
L’institution en conclue que les erreurs humaines sont possibles mais n’ont pas de lien avec la gestion des effectifs en tour de contrôle, comme le soutient Le Figaro. Le système de clairance reste toutefois sujet à caution : la Cour des Comptes se penche dessus depuis quelques mois déjà.