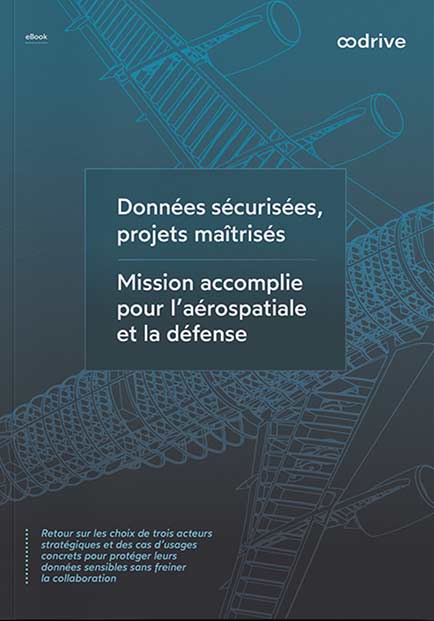Difficile de séparer le bon grain de l’ivraie parmi la multitude d’annonces des industriels et des responsables politiques concernant les enjeux réels de la décarbonation du transport aérien. Pourtant, deux informations majeures viennent d’être révélées en l’espace d’une semaine concernant la future génération de monocouloirs, le segment qui constitue pratiquement les trois quarts du marché mondial en termes de passagers transportés.
La première est venue du patron d’Airbus lors de la présentation des résultats annuels du groupe aéronautique européen, Guillaume Faury annonçant que les activités d’aérostructures resteront au coeur de son outil industriel, une décision stratégique qui entre en cohérence avec ses projets d’avions décarbonés qui pourraient être accompagnés d’architectures nouvelles, en particulier pour l’intégration non conventionnelle des futures motorisations. Pratiquement en même temps, l’avionneur européen signait un accord de coopération avec les Pays-Bas concernant les composites thermoplastiques, des matériaux prometteurs pour l’allègement d’éléments d’aérostructure complexes et pour une production fortement automatisée.
La seconde a quant a elle été avancée par Oliver Andriès, le nouveau patron de Safran qui, profitant aussi de la présentation des résultats annuels de son groupe, a révélé que Safran Aircraft Engines travaillait déjà avec General Electric sur un moteur de « rupture » pour l’horizon 2035, avec des gains significatifs par rapport au moteur LEAP, « d’au moins 20% », et tirant partie « de toutes les leçons acquises sur les démonstrateurs de l’Open Rotor ». Le directeur général de Safran a cependant voulu préciser que le futur moteur ne sera pas nécessairement basé sur une soufflante non carénée.
Ce qui est désormais certain, c’est que Safran et son partenaire américain GE ont désormais une vision qui commence réellement à se préciser quant au successeur du LEAP-1X de CFM International qui viendra motoriser la future génération d’avions de ligne monocouloirs au cours de la prochaine décennie, et en particulier celui qui viendra remplacer l’A320neo d’Airbus. En résonance, l’avionneur européen a nécessairement aussi une idée très précise de son intégration sur son futur avion, et donc de son architecture. Reste maintenant à assister à la maturation et à la convergence de multiples briques technologiques apparues à l’occasion des différents programmes de recherche menée en Europe ces dernières années, par exemple par le biais des travaux du CORAC et de Clean Sky.
Le successeur de l’A320neo sera assurément un avion de rupture et sa conception va prendre du temps. Mais de sa réussite dépend tout simplement l’avenir de près de la moitié de l’industrie aéronautique européenne pendant des décennies.