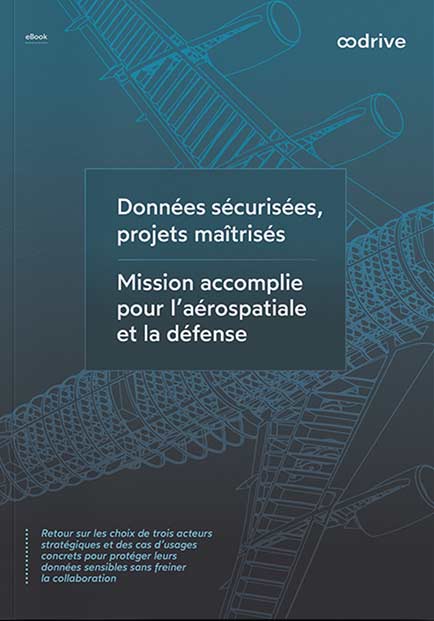L’aéroport de Schiphol fait couler beaucoup d’encre. Après avoir été le symbole du chaos de la reprise du transport aérien en Europe l’année dernière – son manque d’anticipation du retour de la demande a entraîné une pénurie de personnel qui a obligé l’aéroport à plafonner le nombre de vols, situation qui perdure en 2023 -, il est de nouveau sous le feu de la critique pour la décision du gouvernement néerlandais, appuyée par son gestionnaire, d’abaisser la limite du nombre de vols annuels de façon pérenne. Il souhaite qu’elle tombe de 500 000 à 460 000 vols annuels à partir du 1er novembre, voire 440 000 par la suite. L’objectif est de réduire le bruit autour de la plateforme, au bénéfice de la qualité de vie des riverains.
KLM, appuyée par le groupe Air France-KLM, Delta Air Lines, easyJet, Corendon Airlines, TUI, et depuis peu tout l’IATA ont décidé d’attaquer en justice la décision du gouvernement. Tous estiment qu’elle contrevient au règlement européen sur les restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports, en ce qu’elle ne s’est accompagnée d’aucune « consultation sérieuse » de l’industrie et qu’elle a été prise en premier et non en dernier recours. En parallèle, JetBlue a également saisi le ministère des Transports américain pour rapporter des pratiques discriminatoires dans l’attribution de créneaux à Amsterdam, toujours en raison de cette volonté de réduire les nuisances sonores liées à l’aérien.
Le point de vue de l’industrie du transport aérien est limpide : avec une réduction des capacités de l’aéroport, le gouvernement néerlandais sabote sa connectivité et handicape son économie, tout en déstabilisant celle des compagnies aériennes qui y opèrent, et notamment son propre fleuron KLM, qui représente 60 % de l’activité de l’aéroport et ne pourra pas transférer la partie touchée de ses propres activités dans les hubs alentours. L’IATA dénonce une « approche hostile » envers l’aviation, « un dangereux précédent » qui justifie son entrée en action.
L’association souligne que les niveaux de bruit ont été réduits de 50 % au cours des dix dernières années grâce aux améliorations continues apportées aux avions et à leurs moteurs, tandis que des mesures opérationnelles contribuent également à réduire les nuisances (approches continues, roulage sur un moteur…). Et les nuisances sonores diminuent en continu au fur et à mesure que les flottes sont remplacées et s’adaptent aux règlements de plus en plus contraignants de l’OACI sur le sujet.
Mais cela suffit-il ? La décision du gouvernement néerlandais montre aussi les doutes qui peuvent subsister quant à la capacité de l’industrie à réduire suffisamment ses nuisances – qu’elles soient mesurées en volume de bruit ou en émissions de CO2. D’autant que cette réduction du bruit se fait parallèlement à une augmentation continue du trafic, qui, mécaniquement, annule au moins en partie les bénéfices apportés par les évolutions technologiques. En agissant directement sur la limitation du nombre de vols, il fait le choix d’imposer la sobriété dans les déplacements, de voyager moins souvent mais plus durablement, une tendance qui est devenue plus audible avec la crise, portée par les détracteurs du transport aérien mais pas uniquement : le PDG du groupe ADP Augustin de Romanet lui-même a plusieurs fois considéré cette sobriété comme inévitable.
La portée de la limitation des activités de Schiphol, si elle est approuvée par l’Union européenne, devrait toutefois être très limitée. On imagine mal ce « dangereux précédent » avoir des conséquences plus larges, surtout en dehors d’Europe où les projets aéroportuaires peuvent être gigantesques et où la soif de voyage des nouvelles classes moyennes ne fait que croître.